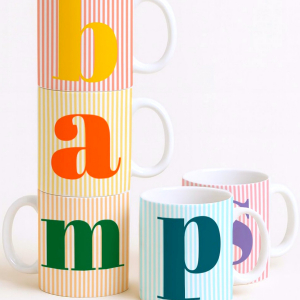Frais universitaires étrangers: injustice ou exigence économique?
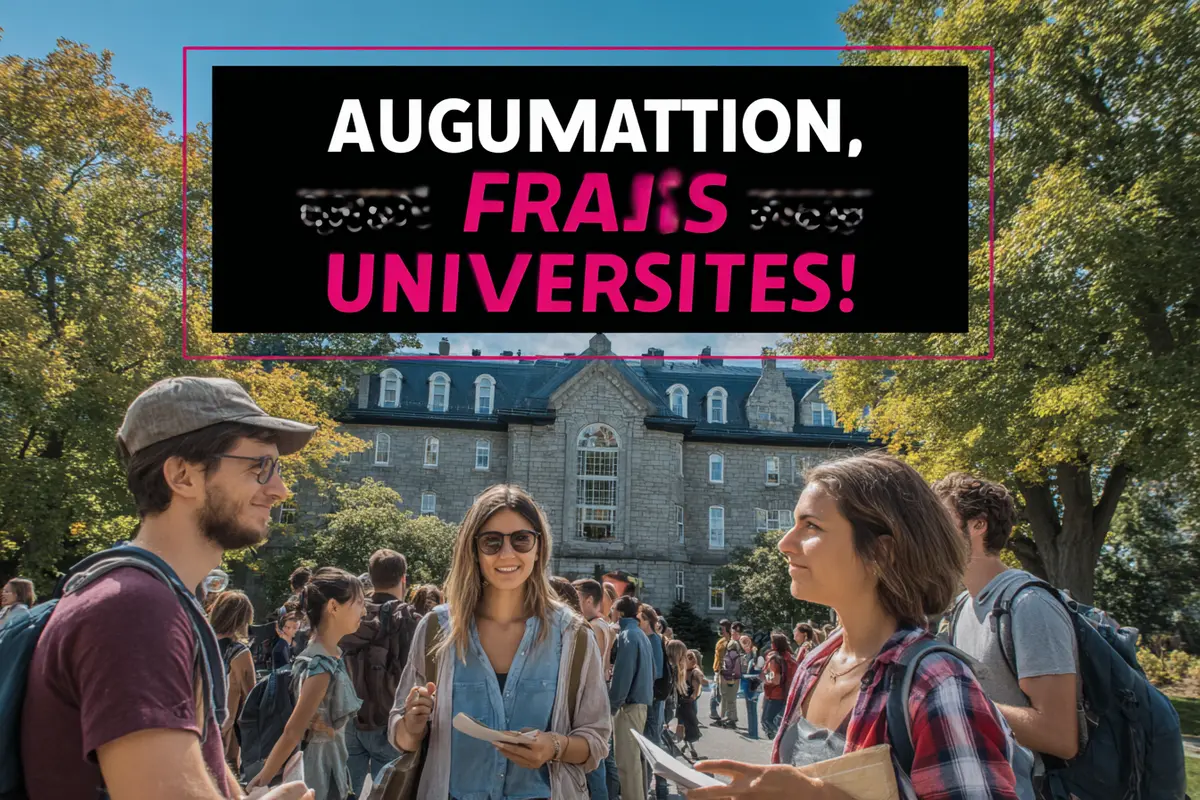
Face à l’augmentation significative des frais de scolarité pour les étudiants étrangers, un débat intense traverse le monde de l’enseignement supérieur. Derrière ce qui est présenté comme un simple ajustement budgétaire se cache une question fondamentale : l’éducation est-elle un bien public universel ou un service qui se monétise sur le marché mondial de la connaissance ? La tension entre ces deux visions redessine les contours de l’attractivité universitaire, notamment en France.
Le témoignage d’Amira, étudiante marocaine en master de biologie à Lyon, illustre concrètement ce dilemme. « Quand je suis arrivée en 2022, je payais les mêmes frais qu’un étudiant français. Pour ma dernière année, on me demande presque dix fois plus. J’ai dû prendre un deuxième emploi, de nuit, en plus de mes études. Mon rêve d’étudier en France est devenu une course contre l’épuisement. » Son cas n’est pas isolé. Il est le résultat direct d’une politique qui bouscule des décennies de tradition d’accueil.
La rupture de la stratégie « Bienvenue en France »
En France, le tournant a un nom : la stratégie « Bienvenue en France », lancée en 2019. L’objectif affiché était d’améliorer l’accueil des étudiants internationaux tout en augmentant les ressources des universités. La mesure phare fut la hausse des frais d’inscription pour les étudiants extra-européens : ils sont passés de 170€ en licence à 2 770€, et de 243€ en master à 3 770€. Le gouvernement a justifié cette hausse par un alignement sur les coûts réels de la formation, estimés à près de 10 000€ par an, et la promesse de réinvestir les fonds dans des bourses et des services d’accueil améliorés.
Pour les universités, confrontées à une baisse relative des dotations de l’État et à une compétition internationale féroce, cette manne financière est apparue comme une bouffée d’oxygène. « Pour rester compétitifs face aux universités anglo-saxonnes, nous devons investir massivement dans nos laboratoires, nos bibliothèques et nos services numériques », explique de manière anonyme le président d’une grande université parisienne. « Les frais différenciés nous donnent une marge de manœuvre que le budget de l’État ne nous offre plus. C’est une question de survie dans le paysage mondial. »
Un modèle économique qui interroge

Les partisans de cette approche soulignent que la France restait l’un des pays les plus abordables au monde pour les études supérieures. Ils pointent vers le Royaume-Uni, le Canada ou l’Australie, où les frais pour les étudiants internationaux peuvent dépasser les 20 000€ par an, générant des milliards de revenus pour l’économie. Dans cette perspective, l’éducation devient un service d’exportation de premier plan, et l’étudiant étranger, un client à attirer.
Cependant, cette logique purement comptable est loin de faire l’unanimité. Des organisations étudiantes comme l’UNEF dénoncent une « sélection par l’argent » qui contredit les principes républicains d’égalité d’accès au savoir. « On ne construit pas le rayonnement d’un pays en fermant la porte aux talents qui n’ont pas les moyens », martèle un de leurs porte-parole. Le risque, selon eux, est de transformer les campus en espaces réservés à une élite économique mondiale, perdant ainsi le brassage social et culturel qui fait leur richesse.
L’enjeu du « soft power » et de l’influence francophone

Au-delà des considérations financières, c’est toute la stratégie d’influence de la France qui est en jeu. Pendant des décennies, accueillir à faible coût les futures élites des pays émergents, notamment du monde francophone, était un pilier du « soft power » français. Ces anciens étudiants, une fois rentrés dans leur pays, devenaient des ambassadeurs naturels de la culture, de la langue et des intérêts économiques français.
Cette nouvelle politique tarifaire risque de rompre ce lien historique. De nombreux étudiants issus du Maghreb ou d’Afrique subsaharienne se tournent désormais vers d’autres destinations comme le Canada, la Belgique ou même la Chine, qui proposent des conditions financières plus attractives. « En voulant gagner quelques centaines de millions d’euros à court terme, la France est peut-être en train de perdre des décennies d’influence diplomatique et économique », analyse un chercheur en relations internationales. Le calcul est complexe : quel est le coût d’un futur dirigeant ou entrepreneur africain qui, au lieu de parler français et de faire des affaires avec la France, se tournera vers des partenaires anglophones ou sinophones ?
Face à la controverse, des ajustements ont été faits. De nombreuses universités ont utilisé leur autonomie pour exonérer une partie de leurs étudiants internationaux des frais majorés, limitant ainsi l’impact de la réforme. Des programmes de bourses ciblées ont été développés. Mais le principe demeure. Le débat est loin d’être clos et il révèle une fracture profonde sur la mission de l’université publique. Doit-elle être un bastion de l’universalisme, accessible à tous les talents, ou une entreprise de la connaissance, contrainte de s’adapter aux lois du marché mondial ? La réponse à cette question déterminera non seulement le visage des campus de demain, mais aussi la place de la France dans le dialogue des cultures et des savoirs.